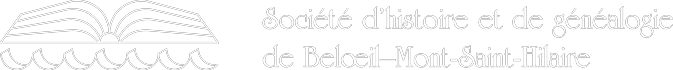Capsules d'histoire - Mémoire des femmes
Françoise Loranger (1913-1995) : sous le signe du lion

L’œuvre de cette femme passionnée a marqué bien des générations. On se souvient de la série « Sous le signe du lion » diffusée à Radio-Canada en 1961 et en 1997. Les thèmes chers à Loranger s’y trouvent : la famille bourgeoise avec ses secrets, les classes sociales, l’adultère et l’euthanasie, le nationalisme, le catholicisme omniprésent. Si la série a bousculé des bien-pensants à l’époque, elle en a ravi plusieurs et demeure célèbre.
Françoise Loranger naît en 1913 à Saint-Hilaire dans une famille de la grande bourgeoisie qui lui lègue une soif pour la culture et la liberté d’esprit qui imprégnera tous ses écrits. Diplômée en lettres et en sciences, à 17 ans, elle publie des nouvelles dans des revues aussi diverses que la « Revue populaire », le « Bulletin des agriculteurs » ou le « Quartier latin ». Son style élégant et précis attire l’intérêt des lecteurs. Vers 1939, elle écrit des scénarii pour la radio. « Mathieu » (1949) devient un roman classique où elle explore la quête de soi et le désir de dépasser sa condition hors de l’Église.
Dès 1960, ses pièces sont jouées sur scène et au petit écran, la confirmant grande dramaturge de la famille et des questions féministes et politiques : Une maison, un jour (1965), Encore cinq minutes (1967, Prix du Gouverneur général en 1968), Double jeu (1969), Jour après jour, Un si bel automne (1971). S’éloignant du théâtre traditionnel, elle écrit Le chemin du Roy (1967) et Médium saignant (1970).
Mariée deux fois, mère de deux filles, elle vit ses vingt dernières années loin de l’effervescence littéraire, à Saint-Marc en bordure du Richelieu, jusqu’à son décès en 1995, à presque 82 ans. Des rues, une bibliothèque, un cercle littéraire ont adopté son nom, soulignant ainsi son importance dans la littérature québécoise.
— Louise Langevin
Références
« Françoise Loranger », Wikipédia, consulté le 4 octobre 2024.
« Archives | Françoise Loranger, romancière et dramaturge résolument moderne, s’éteignait il y a 25 ans », Radio-Canada, consulté le 4 octobre 2024.
Bibliothèque et Archives nationales du Québec, Notice du Fonds Françoise Loranger 1947-1993, Advitam, consulté le 4 octobre 2024.
Jean-Pierre Crête, Françoise Loranger : la recherche d’une identité, Montréal, Léméac, 1974, 148 p. (collection Documents)
Denise Daigle et Marthe Goulet, Cahier généalogique. De Pierre Rivard à Françoise Loranger, Cercle littéraire Françoise Loranger, 2013, 48 p.