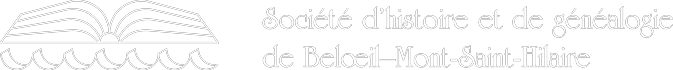Zone membre - Beloeil-Station
Notes pour servir à l’histoire des principales maisons anciennes et bâtiments patrimoniaux de Beloeil – Beloeil-Station
— Pierre Gadbois

Avant-Propos
Parmi tous les projets nous avons entrepris, les surprises les plus agréables sont venues de la recherche menée sur le terrier et nombre de travaux que nous avons réalisés depuis découlent directement de ces découvertes. Malheureusement, trop sollicité par d’autres projets aussi urgents qu’importants, nous doutons de pouvoir un jour terminer la reconstitution complète du terrier de Beloeil.
Plus urgent que la seule reconstitution du terrier et bien que néophyte en matière d’architecture et de patrimoine bâti, nous avons été amenés à nous intéresser de près aux bâtiments érigés sur ces terres et particulièrement sur ceux qui existent encore aujourd’hui. Pendant les trente années qu’aura duré cette quête, nous avons été à même de constater la dégradation constante qu’a subi notre patrimoine bâti, jusqu’à en perdre son identité et souvent même disparaître. Nous avons ainsi à maintes reprises été confronté par l’urgence de réagir face à la disparition et la détérioration de plusieurs bâtiments.
Il faut bien se rendre à l’évidence que malgré toute la bonne volonté qu’ils y mettent, ceux qui ont la responsabilité de veiller à la protection et la mise en valeur de notre patrimoine, ne semblent pas en mesure d’exercer ce pouvoir. Il n’existe peu ou pas de volonté politique dans l’une ou l’autre des corporations municipales de Beloeil, McMasterville et Saint-Mathieu-de-Beloeil pour protéger notre patrimoine. À notre connaissance aucune de ces municipalités n’a encore eu le courage de citer l’un ou l’autre des bâtiments patrimoniaux jalonnant son territoire afin de le protéger ou de lui accorder une reconnaissance quelconque.
Pourtant, notre patrimoine est ce qui nous caractérise, ce qui nous identifie, ce que nous sommes et ce que nous laisserons aux générations futures. Il constitue ni plus ni moins l’identité des générations futures à qui nous avons le devoir de le rendre dans son intégralité.
La plupart du développement domiciliaire qui se fait sur l’ensemble de notre territoire depuis les années cinquante a eu un effet pour le moins réducteur sur le plan patrimonial, dans la mesure où ce développement ne tient rarement compte des caractéristiques identitaires de notre région. Ce développement n’est pas différent de tout de que nous pouvons retrouver dans toutes les banlieues de toutes les villes sur tout le territoire de la Province de Québec.
Un rapide inventaire des bâtiments anciens qui s’y trouvent nous force de constater que notre patrimoine architectural se détériore à la vitesse grand V. Il est malheureusement de plus en plus difficile de qualifier certains de nos bâtiments anciens de patrimoniaux alors qu’ils véhiculent encore un intérêt historique indéniable. Nous constatons également de plus en plus que beaucoup de décisions malheureuses sont prises à l’égard du patrimoine bâti et qui sont une conséquence directe d’un certain laxisme de la part des autorités ou de gestes malheureux posés par certains propriétaires en raison d’un permis ou autorisation de démolir ou de modifier, accordé dans le passé.
En guise d’exemple, il suffit de se rappeler la démolition il y a quelques décennies de la maison Bélanger sur le chemin Yvon-L’Heureux Nord, construite vers 1793 et remplacée par une canadienne bien ordinaire, et de la maison Brillon, construite en 1856, démolie dans le seul but de construire à sa place une résidence dite de prestige qui, de toute évidence n’a pas sa place à cet endroit. La décision récente de démolir ce qui fut le siège du Cercle Athlétique et Dramatique de Beloeil, fondé en 1890, premier établissement théâtral à voir le jour à Beloeil, construit en 1891, est une conséquence directe de cette première décision. Sans parler de la saga qui s’est prolongée pendant plus de 20 ans autour de la maison Robert, la plus vieille maison de bois de toute la Vallée du Richelieu, construite avant 1750, restaurée à la perfection, détériorée, honnie, pourrie, laissée pour compte mais sauvée tout récemment in extrémis d’une démolition assurée… mais à quel prix pour son intégrité, que dis-je, pour notre fierté et notre identité?
Impuissant et profondément déçu du sort qui est réservé à nos bâtiments anciens et conséquemment à notre histoire, nous avons entrepris malgré nos limites et notre faible connaissance de l’architecture, de faire l’histoire de ce qui reste de notre patrimoine bâti, en espérant que notre intervention puisse freiner cette marche vers sa banalisation à tout crin, à l’ère du canExel et autres matériaux du même acabit.
Un premier volet de cette démarche a déjà été entamé grâce à l’appui de l’ancien maire de Saint-Mathieu-de-Beloeil, monsieur Jean Paquette. Nous avons déjà ébauché l’histoire de la plupart des bâtiments anciens de cette municipalité dans un document intitulé Notes pour servir à l’histoire des principales maisons anciennes et bâtiments patrimoniaux de Saint-Mathieu-de-Beloeil, toujours à l’état d’ébauche et rédigé en 2009 en préparation d’une conférence tenue dans le cadre des Journées de la Culture.
Ce premier volet des Notes aura servi de modèle à celui que nous entreprenons aujourd’hui concernant les bâtiments anciens de Beloeil. Nous abordons ce deuxième volet suivant une approche beaucoup plus détaillée que celle adoptée pour les bâtiments de la municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil. Notre intention est bien sûr de faire systématiquement l’historique de la plupart des bâtiments présentant un intérêt architectural et/ou historique quelconque sur tout le territoire de Beloeil.
Nous avons entrepris notre recherche sur le patrimoine bâti de Beloeil en commençant par Beloeil-Station simplement parce que nous avons suivi plus ou moins l’ordre chronologique des lots suivant leur numérotation au cadastre et leur situation à travers les rues ouvertes le long des deux grand axes que forment la rue Richelieu et le boulevard Yvon-L’Heureux. Notre étude commence dans la première concession aux limites sud-ouest de la ville de Beloeil, le long des rues Bernard-Pilon et Richelieu, pour se poursuivre jusqu’aux limites nord-est, le long de la ligne séparant la ville de Beloeil de la Municipalité de Saint-Marc-sur-Richelieu. Nous y inclurons également toutes les incursions nécessaires le long des rues et à travers certains secteurs comme Beloeil- Station et le Vieux-Beloeil, pour revenir ensuite sur les terres de la deuxième concession le long du boulevard Yvon-l’Heureux, jusqu’aux limites de Saint-Basile-le-Grand.
Ce premier volume contient donc l’histoire du patrimoine bâti de Beloeil- Station. Il nous a cependant été difficile de suivre l’ordre chronologique des lots 25, 26, 28 et 30 du cadastre, composant ce quartier, à travers les diverses rues qui le sillonnent. Par conséquent, pour se retrouver à travers le dédale des rues où se trouvent les maisons retenues dans ce volet de notre étude, nous recommandons au lecteur de consulter le plan et l’index des bâtiments retenus qui suivent.
— Pierre Gadbois
Introduction
Le terme Belœil-Station n’a évidemment été utilisé qu’après l’établissement de la voie ferrée en 1848. La voie ferrée traversait en effet les dix premières concessions de la seigneurie de Belœil à environ trois arpents de la rivière, jusqu’au pont qui traverse le Richelieu pour poursuivre sa route vers Saint-Hyacinthe et à proximité duquel fut installée la gare de Belœil.
Avant cette date, cette partie de la seigneurie de Belœil avait déjà fait l’objet de deux appellations différentes : le domaine et le secteur du petit-rapide. Dès son acquisition de la seigneurie et de son augmentation en 1711, Charles Lemoyne, seigneur de Belœil établit son domaine dans ce secteur de la seigneurie, au sud-ouest du lot actuel 33 du cadastre, sur 12 arpents de front le long de la rivière Richelieu, englobant la totalité du secteur actuel de Belœil-Station. Le lieu était également appelé le petit-rapide en raison du coude que forme la rivière au bout de la rue Choquette sur le lot no 30 du cadastre, formant à cet endroit de la rivière un petit rapide qui a parfois donné son nom au secteur. Or, une cinquantaine d’année plus tard, le domaine est installé ailleurs dans la seigneurie et ne sera plus utilisé pour identifier cette partie de la seigneurie pas plus que celui du petit-rapide qui n’a jamais été retenu pour désigner l’agglomération elle-même.
Belœil-Station et autres appellations
C’est grâce surtout aux installations dès 1848 de la Compagnie du chemin à lisse Saint-Laurent et Atlantique et plus tard celles de la Compagnie de chemin de fer Grand Tronc, et de l’établissement en 1878 de la Hamilton Powder Co., usine communément appelée la Poudrière, que le secteur va se développer. Les nombreux ouvriers, entrepreneurs et artisans, travaillant pour l’une ou l’autre des entreprises qui se sont établies à proximité, vont tranquillement créer une agglomération qui prendra le nom de Belœil-Station.
En 1860, on ne retrouve encore autour de la gare de Belœil que quatre bâtiments, tous construits le long de la rue Richelieu : deux maisons de pierres dont l’une est transformée en auberge, la gare elle-même et la maison de briques du docteur Jean- Baptiste Brousseau qui ambitionne de développer tout le secteur suite à son projet de lotissement entrepris depuis 1856. Ce projet ne prendra cependant son essor qu’au début du XXe siècle. Les limites territoriales de Belœil-Station s’étendent alors plus ou moins de la Poudrière à l’ouest jusqu’à la maison du docteur Brousseau à l’est, mais à cette date, le terme n’est pas encore utilisé.
En plus du projet de lotissement de Jean-Baptiste Brousseau en 1856, peu après avoir acquis la terre située au nord-est de la gare, un autre projet, conçu cette fois par Jean-Baptiste Leblanc, le chef de gare de Belœil, va également voir le jour en 1887 sur un terrain enclavé derrière la gare. Or ni l’un ni l’autre de ces projets ne se développera du vivant de son auteur. Jean-Baptiste Brousseau ne fera tout au plus qu’isoler sur un des emplacements figurant sur son plan, l’auberge qu’il exploite dans la maison de pierre déjà construite sur la terre au moment de l’acquérir et fait construire sa propre maison sur un emplacement voisin. Quant à Jean-Baptiste Leblanc, son lotissement est enclavé derrière la gare où il fera malgré tout construire une maison de trois logements, consacrant cependant plus de temps à trouver une voie d’accès à ce bâtiment, qu’à développer son lotissement. Il faudra attendre l’année 1904 pour qu’un véritable projet de développement immobilier, beaucoup plus important que ceux initiés précédemment, ne soit entrepris après l’achat par Cyrille Choquette de la terre occupée antérieurement par son beau-père, le docteur Jean-Baptiste Brousseau.
Cyrille Choquette, d’abord cultivateur, avait commencé par acquérir les lots 26 et 28 du cadastre avant d’acquérir en 1904, la terre de Jean-Baptiste Brousseau, composée de la presque totalité du lot no 30. En 1904, il était donc propriétaire de tout le territoire situé au nord-ouest et sud-ouest de la voie ferrée depuis la montée des Trente (aujourd’hui rue Bernard-Pilon) jusqu’à la ligne de division entre les lots 30 et 32 du cadastre. N’était pas cependant incluses dans ce lotissement, la partie du lot 28, lotie en 1887 par Jean-Baptiste Leblanc, propriété en 1904 de Frank McCrea. Ce projet n’incluait pas non plus le lot no 25 situé au sud-est du lot no 26, entre la voie ferrée et la rivière, propriété depuis 1852 du Grand Tronc.
Dès 1904, Cyrille Choquette entreprend de vendre des emplacements. Il possède donc de toute évidence un plan de lotissement, plan qu’il a sans doute fait dresser par un arpenteur. Comme les lots qu’il vend ne sont encore que des parties du lot originaire qu’il ne fait pas subdiviser officiellement, le plan n’est donc pas déposé pour enregistrement et s’est perdu. Son lotissement couvre quand même toute la partie sud-est des lots 26 et 30 du cadastre et la partie sud-est du lot 28 limitée à la voie ferrée et le lotissement de Jean- Baptiste Leblanc. En 1904, ce lotissement se trouve inclus dans les limites du territoire dans la toute nouvelle Corporation municipale du Village de Belœil créée quelques mois auparavant, en décembre 1903. Certains des terrains compris dans le lotissement de Cyrille Choquette seront donc identifiés de temps à autre comme faisant partie du «Village de Beloeil», la seule véritable identification officielle de ce secteur. Mais Cyrille Choquette avait baptisé lui-même son lotissement du nom de «Terrasse Choquette» qu’il sillonne de rues qu’il nomme rues Choquette, Corinne, Brousseau et de Rouville, provenant des noms de sa famille et celle de son épouse. Le nom «Terrasse Choquette» sera utilisé beaucoup plus souvent que le nom «village» et sera repris par d’autres promoteurs plus tard pour désigner une partie de ce lotissement après le dépôt de divers plans de subdivision de ce territoire à compter de 1913.
Mais le terme «Terrasse Choquette» ne pouvait désigner que les terrains inclus dans le lotissement de Cyrille Choquette et ceux présentés par ses successeurs après 1913, excluant par conséquent le lot no 25 et le lotissement de Jean-Baptiste Leblanc.
Pendant un certain temps, le nom Belœil-Station va donc devoir rivaliser avec ceux de la Terrasse Choquette et du village de Belœil, mais ces deux expressions ne parviendront pas à détrôner celui de Belœil-Station bien que celui-ci ne détient aucun fondement juridique contrairement aux deux autres. L’expression n’a en effet rien d’officiel et elle subsistera même si ses limites débordent encore sur le territoire de la municipalité de la paroisse Saint-Mathieu-de-Belœil, désigné alors simplement comme «la paroisse» par opposition au «village», et ce jusqu’à la création de la paroisse Sacré- Cœur de McMasterville et la Corporation municipale de McMasterville en 1917, dont la limite nord-est sera la montée des Trente ou rue Bernard-Pilon.
Le Pont
Mais au début du XXe siècle une autre expression fait son apparition pour désigner le secteur situé autour de la gare de Belœil : le Pont.
L’expression référait évidemment au pont ferroviaire. Elle est déjà utilisée en 1903 et existait peut-être bien avant cette date. Nous ignorons quand et comment cette appellation est née, et quelles en étaient les limites exactes à cette date.
Nous retrouvons l’expression utilisée dans les procès-verbaux de la Commission scolaire de la municipalité du village de Belœil le 12 octobre 1903, identifiant sous le nom de «la maison d’école du pont», l’école de l’arrondissement no 3 de la commission scolaire. Cette école était située au coin du chemin de la première concession et de la montée des Trente (aujourd’hui les rues Richelieu et Bernard-Pilon) et ce avant même la création de la Corporation municipale du village de Belœil en décembre 1903. L’expression sera utilisée à intervalle régulière par les commissaires d’écoles et plus tard par les autorités religieuses lors du recensement paroissial de la paroisse Saint-Mathieu- de-Belœil, dressé entre 1916 à 1921 et entamée avant la création de la paroisse Sacré- Coeur.
À cette date les deux expressions Belœil-Station et le Pont ont probablement désigné le même territoire mais peut-être définies différemment. Le territoire défini par l’expression le Pont devait être limité au seul arrondissement scolaire no 3 dont les frontières avaient dû être clairement définies par une décision des commissaires d’école alors que Belœil-Station conservait toujours l’imprécision qui l’a toujours caractérisée. Dans les deux cas cependant leur territoire se prolongeait tout de même dans la «paroisse», sur le territoire de la future municipalité de McMasterville mais excluait au nord-ouest, dans le cas du «Pont» ou de l’arrondissement scolaire no 3, le territoire de la paroisse situé au nord-ouest de celui de la municipalité du village de Belœil situé près de l’emprise actuelle de la rue Cartier. En plus de déborder sur le territoire de la paroisse, les deux expressions incluaient celui couvert par le plan de lotissement de Choquette, la «Terrasse Choquette», celui couvert par l’ancien lotissement de Jean-Baptiste Leblanc et enfin par tout le lot 25, au sud de la voie ferrée, appartenant à la Compagnie de chemin de fer Grand Tronc où plusieurs bâtiments vont se construire dont en particulier l’école de l’arrondissement no 3 de la Commission scolaire.
Mais la création de la paroisse Sacré-Cœur et de la municipalité de McMasterville en 1917, allait modifier encore une fois les limites territoriales couvertes par ces deux expressions et les réduire au seul territoire situé à l’intérieur des limites du village de Belœil et plus tard de la ville de Belœil.
Avec la création de la paroisse Sacré-Cœur en 1917, les deux expressions «Belœil-Station» et le «Pont», subsisteront ensemble et continueront d’être utilisées pour désigner un même territoire, différent du précédent, qui allait cependant exclure celui de la nouvelle paroisse Sacré-Cœur et tout le territoire de McMasterville. Le territoire situé à l’ouest de la Montée des Trente cesse d’être désigné comme faisant partie de Belœil- Station et est dorénavant désigné sous son nom actuel de la municipalité de McMasterville. La création de la nouvelle municipalité entraînera la création d’une nouvelle commission scolaire et le «Pont» cessera d’être utilisé par les autorités scolaires pour identifier un arrondissement. L’expression reste cependant utilisée par les autorités religieuses et, selon d’anciens résidents, elle prend alors une connotation péjorative en désignant toute cette partie de la paroisse Sacré-Cœur de McMasterville, située sur le territoire de la ville de Belœil.
Mais les deux expressions se confondent et ne comprennent plus à compter de 1917 que le territoire situé dans la première concession, à l’intérieur des limites de la ville de Belœil, depuis la rue Bernard-Pilon jusqu’aux limites nord-est du lot no 30 du cadastre, passé la rue Choquette. En profondeur, ce territoire ne dépasse pas non plus les limites de la ville de Belœil et comprend tout le territoire situé entre la rivière Richelieu et une ligne passant à proximité de l’emprise nord-ouest de la rue Cartier. Mais exceptionnellement, elle incluait l’emplacement de deux familles dont les bâtiments débordaient légèrement dans la «paroisse», les familles d’Émile et Auguste Casavant qui occupaient des maisons et des bâtiments situés légèrement au-delà de la rue Cartier, que le recensement paroissial indique simplement comme étant «dans le champ».
L’expression le Pont comprenait donc essentiellement le même territoire mais était presque uniquement utilisée pour distinguer, dans la paroisse Sacré-Cœur de McMasterville, cette partie de la paroisse située sur le territoire de Belœil par opposition à la partie située entièrement dans McMasterville.
De plus, même si l’expression le «Pont» a été utilisée pendant très longtemps, elle n’était pas utilisée en général par les personnes habitant le territoire de Belœil- Station. Plusieurs anciens résidants de Belœil-Station dont monsieur Bernard Handfield et madame Geneviève Casavant se souviennent très bien de cette expression qu’ils percevaient comme péjorative, était utilisée que par les gens qui n’habitaient pas le secteur du «Pont». Les gens de l’extérieur disaient ainsi se rendre au Pont pour aller chez quelqu’un habitant Belœil-Station, alors que les gens habitant le quartier utilisaient invariablement l’expression Belœil-Station pour désigner leur quartier, la seule expression d’ailleurs utilisée comme adresse postale.
L’expression Belœil-Station prendra finalement le dessus et le «Pont» cessera d’être utilisé lors de la création en 1952 de la paroisse Sainte-Marie-Goretti et le quartier du même nom au nord de la rue Laurier.
Le développement immobilier de Belœil-Station
En 1852, Louis Comtois cède une partie de sa terre à la Compagnie de chemin à lisse St-Laurent et Atlantique ce qui l’obligera à déménager sa maison et ses bâtiments de l’autre côté du chemin de Montée sur le territoire actuel de McMasterville. Cette terre formera les lots nos 25 et 26 lors de l’ouverture du cadastre en 1879. Jusqu’en 1880, les seules maisons construites sur le territoire de Belœil-Station sont donc celles des propriétaires des deux autres terres composant aujourd’hui Belœil-Station, soit les lots nos 28 et 30 du cadastre dont les maisons étaient situées exclusivement le long du chemin de la première concession ou rue Richelieu. Il s’agit de la maison de Jean-Baptiste- Lamothe, construite en 1824, la maison de pierre que le docteur Jean-Baptiste Brousseau transforme en auberge, construite en 1775 et la maison Brousseau que Jean-Baptiste Brousseau fait lui-même construire en 1860. Il faut ajouter les bâtiments construits par la compagnie de chemin à lisse ou la Compagnie du Grand Tronc le long de sa voie d’évitement sur le lot no 25. Tout ce secteur ne commencera vraiment à se développer qu’après 1880 et il faudra attendre 1904 pour qu’il se développe encore davantage. Les bâtiments qui vont s’y construire le seront dans le style qui a marqué toute cette période, soit le style vernaculaire industriel suivant les divers modèles qu’il a véhiculés : la maison vernaculaire américaine ou de la Nouvelle-Angleterre, le modèle boom-town ou boite-carrée, nettement le plus populaire à Belœil-Station et le modèle cubique ou Four- Squares américain.
Le quartier de Belœil-Station a d’abord été un quartier de commerçants et d’entrepreneurs avant de devenir au début du XXe siècle, un quartier d’artisans et d’ouvriers. Le long du chemin de la première concession (aujourd’hui rue Richelieu), les premiers établissements commerciaux se développeront sur le lot no 25, acquis en 1852 par la Compagnie de chemin à lisse St-Laurent et Atlantique, compagnie qui sera acquise plus tard par la Compagnie de chemin de fer Grand Tronc avant d’être finalement intégrée dans la Compagnie des chemins de fer nationaux (CNR), connue aujourd’hui sous le sigle CN. Cette dernière y avait installé une voie d’évitement qui dirigeait les wagons le long de bâtiments érigés sur le bord de l’eau, près du pont ferroviaire. Le Grand Tronc construira également sur ce lot une maison pour ses employés et finira par louer les autres terrains qu’elle détenait à cet endroit. La voie d’évitement deviendra rapidement une voie utilisée à des fins commerciales par les différents commerces qui vont s’installer le long de cette voie, dont une meunerie, un moulin à scie, un atelier de menuiserie et des hangars. Des commerces vont également s’établir sur le bord de l’eau, de part et d’autre du pont ferroviaire, ainsi qu’un magasin général et un hôtel. Diverses manufactures et un moulin à scie vont également s’installer un peu plus tard sur le lot no 26, au nord-ouest de la voie ferrée. En 1904, une banque va également s’installer à Belœil-Station, dans un bâtiment construit à cette date par Cyrille Choquette, la Eastern Township Bank, première institution financière à s’établir à Belœil, preuve que l’industrie et le commerce étaient plus florissants dans ce secteur qu’il ne l’était à la même époque dans le village de Belœil.
C’est dans les rues qui vont s’ouvrir à proximité, que vont s’installer les employés du Grand Tronc, de la Poudrière et des diverses manufactures qui foisonnent dans ce quartier, faisant passer graduellement la vocation essentiellement commerciale du quartier vers un quartier ouvrier. Les rues Choquette, Corinne, De Rouville, Perreault et Saint-Georges, à une exception près, commencent à se développer à compter de 1905, date à laquelle Cyrille Choquette développe, le premier, un projet de lotissement de ce secteur.
L’architecture des bâtiments construits à Belœil-Station.
La grande majorité des maisons qui vont être construites à Belœil-Station sont composées de deux logements mitoyens de deux étages chacun. Dans plusieurs cas, elles sont la propriété de cultivateurs, commerçants ou entrepreneurs qui louent d’abord les deux logements qui souvent seront éventuellement acquis par un des locataires ou par un ouvrier venu travailler dans le secteur. Le style vernaculaire industriel, particulièrement le style boom-towm, se prête facilement à la clientèle ouvrière du quartier et à ce type de bâtiment pouvant contenir plus d’un logement. Il s’agit d’une structure simple, peu dispendieuse, facile à construire, et dont les deux étages peuvent loger de grandes familles.
Quelque soit la clientèle visée, les bâtiments restent quand même construits au goût du jour, que ce soit à Belœil-Station, au village de Belœil ou dans la campagne. Dans 99% des cas, c’est le style vernaculaire industriel qui prévaut à cette date, suivant les trois modèles mentionnés précédemment : le style vernaculaire américain ou de la Nouvelle-Angleterre, le style boom-town et le style cubique ou Four-Squares. Si la fin du XIXe siècle voit davantage de maisons érigées dans le style vernaculaire américain, au début du XXe siècle, c’est définitivement le style boom-town ou boite-carrée qui vole la vedette le long des rues Choquette, Corinne et De Rouville.
Ce phénomène se reproduit d’ailleurs partout sur le territoire de Belœil. Ainsi dans le village où le développement immobilier a débuté autour de 1845-50, ce sont des maisons déjà construites, la plupart dans le style des cottages rustiques américains en pièces sur pièces avec des toits à deux versants, qui seront relevées et transformées selon le modèle boom-town.
Jusque vers 1960, les maisons de Belœil-Station n’ont guère changé et conservent encore toute leur authenticité. Cependant à compter de cette date, un engouement de rénovation frappe le secteur, de nouveaux matériaux font leur apparition dont le papier-brique et le bardeau d’amiante, suivi ensuite à compter de 1970 du revêtement en déclin d’aluminium. La majorité des bâtiments de bois verront ainsi leurs murs dissimulés sous les matériaux à la mode dont la durée de vie ne dépasse rarement une vingtaine d’année. Aujourd’hui, les maisons qui ont conservé toute leur intégrité se comptent malheureusement sur les cinq doigts de la main. Il s’agit de la maison Exobie- St-Georges, la maison Gravel, à certains égards la maison Émérie-L’Heureux ainsi que quelques autres maisons de briques dont les rénovations n’ont que peu affecté leur intégrité. Mais la plupart des maisons en bois, ont vu leurs murs disparaître sous de nouveaux revêtements de papier brique, d’aluminium, de vinyle, de bardeau d’amiante, de clapboard de masonite et de canExel. Toutes ces modifications ont eu pour effet de faire disparaître le peu d’éléments décoratifs typiques au style boom-town. Ces rénovations n’auront contribué qu’à enlaidir le paysage architectural qui ressemble davantage à une agglomération de bâtiments qui a perdu son identité sous l’amas des matériaux en composite qui les habillent.
Cependant, plusieurs de ces modifications sont quand même réversibles et plusieurs bâtiments pourraient ainsi retrouver en bonne partie leur intégrité, moyennant certains travaux de restauration.
Nous constatons en effet que la tendance est à la restauration qui respecte de plus en plus l’intégrité des bâtiments. De plus en plus, nous voyons des bâtiments retrouver un revêtement en bois et des chambranles autour des fenêtres à peu près similaires à celles qui existaient à l’origine.
Une meilleure connaissance de notre patrimoine bâti, quelque soit son état actuel, s’il n’a jamais fait trop bouger les administrations municipales, permettra-t-elle du moins aux propriétaires de ces bâtiments à mieux connaître leur patrimoine, à le respecter et à mieux le protéger.

Photo Pierre Gadbois 2011
La maison Henri-Guertin
203 et 209, rue Bernard-Pilon
Lot Ptie 26, cadastre de Beloeil
Feuilleter au complet (pour membre seulement) Se connecter Devenir membre
La maison sise aux nos 203 et 209, rue Bernard-Pilon, a été érigée vers 1910 par Henri Guertin, menuisier de Beloeil, sur une partie du lot 26 du cadastre de la paroisse Saint-Mathieu-de-Beloeil. L’emplacement était situé à la limite sud-ouest de la Municipalité du Village de Beloeil lorsqu’Henri Guertin l’a acquis de Cyrille Choquette en 1907. Il s’agit d’une maison construite en partie dans le style boom-town mais dont la dominante est le style vernaculaire américain. Sa situation géographique à proximité du viaduc de la rue Bernard-Pilon et de la rue Saint-Georges ainsi que plusieurs modifications malheureuses n’auront cependant pas jouées en sa faveur.

Photo Pierre Gadbois 2009
La maison Honoré-Routhier
12, rue Richelieu
Lot Ptie 25, cadastre de Beloeil
Feuilleter au complet (pour membre seulement) Se connecter Devenir membre
La maison située au no 12, rue Richelieu, est construite sur le lot 25 du cadastre de la paroisse Saint-Mathieu-de-Beloeil. Ce lot mesurant environ 3 arpents de profondeur depuis la Rivière Richelieu, sur toute la largeur de la concession qui était également de 3 arpents, avait été détaché de la concession originaire le 27 octobre 1852 lorsque Louis Comtois, alors propriétaire de cette terre, le vendait à la Compagnie du chemin à lisse Saint-Laurent et Atlantique1. Cette compagnie sera acquise plus tard par la Compagnie de chemin de fer Grand Tronc et cette dernière par la Compagnie des chemins de fer nationaux (CNR), connu aujourd’hui sous le sigle CN.

Photo Pierre Gadbois 2009
La maison Jean-Marie-Perreault
48, rue Richelieu
Lot Ptie 25, cadastre de Beloeil
Feuilleter au complet (pour membre seulement) Se connecter Devenir membre
Les circonstances entourant l’acquisition de cet emplacement et la construction par monsieur Jean-Marie Perreault de la maison sise au 48, rue Richelieu, restent nébuleuses. Comme pour ses voisines, cette maison a été construite sur un terrain loué de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (CN) et les premiers renseignements officiels concernant ce bâtiment ne remontent qu’à 1955. Au moment du décès à cette date de Jean-Marie Perreault, son épouse déclare simplement qu’il laisse dans sa succession la maison située au 48, rue Richelieu, construite sur le lot 25 « loué de la Compagnie des chemins de fer du Canada.»

Photo Pierre Gadbois 2009
La maison Amédée-Asselin
52 et 54, rue Richelieu
Lot Ptie 25, cadastre de Beloeil
Feuilleter au complet (pour membre seulement) Se connecter Devenir membre
La maison Amédée-Asselin, sise au 52 et 54, rue Richelieu, à Beloeil, est une autre maison construite sur le lot no 25 du cadastre de la paroisse Saint-Mathieu-de- Beloeil, qui appartenait à la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (CN). La compagnie du chemin à lisse du Saint-Laurent et de l’Atlantique, acquise plus tard par la Compagnie de chemin de fer Grand Tronc et ensuite par la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (CN), était propriétaire de ce lot depuis 1852. Elle avait installé sur ce lot une voie d’évitement de son réseau ferroviaire et certains bâtiments qu’elle laissait à la disposition de ses employés. Après plusieurs années, cette voie d’évitement a été abandonnée et la compagnie, tout en restant propriétaire du lot, permit à plusieurs personnes de s’y établir, n’accordant cependant aux occupants qu’un bail à long terme. Ces locataires ont pour la plupart construit des maisons et des bâtiments. Même si le bail ne l’autorisait pas explicitement, le CN ne semblait pas l’empêcher.

Photo Pierre Gadbois 2009
La maison Herménégilde-Perreault
80, rue Richelieu
Lots Ptie 27 et ptie 28, cadastre de Beloeil
Feuilleter au complet (pour membre seulement) Se connecter Devenir membre
La maison sise au 76, rue Richelieu, à Beloeil, est un démembrement de la concession accordée en 1774 à Jean-Baptiste Charron dit Cabana, sur laquelle son gendre, Jean-Baptiste Lamothe a construit la maison de pierre qui porte aujourd’hui les nos domiciliaires 96 et 98, rue Richelieu.
Au cours du XIXe siècle cette concession passe à Michel Gaboriau dit Lapalme, gendre de Jean-Baptiste Lamothe, qui, en 1864, vend la terre et la maison de pierre à Stephen Dillon pour aller s’établir à Saint-Venant de Hereford.

Photo Pierre Gadbois 2009
La maison Joseph-Arthur-Archambault
80, rue Richelieu
Lot Ptie 28, cadastre de Beloeil
Feuilleter au complet (pour membre seulement) Se connecter Devenir membre
La maison sise au 80, rue Richelieu a été construite vers 1920, quelques années après la maison Herménegilde-Perreault, par Joseph-Arthur Archambault, alors député-protonotaire de la Cour supérieure du district de Montréal.
La terre sur laquelle la maison Joseph-Arthur-Archambault a été construite est le lot no 28 du cadastre de Beloeil. Cette terre, sur laquelle se trouve la maison de pierre de deux étages sise aux nos 96 et 98, rue Richelieu, construite par Jean-Baptiste Lamothe en 1824, sera acquise par son gendre Michel Gaboriau dit Lapalme qui la conserve pendant une quarantaine d’années avant de la vendre à Stephen Dillon1, ancien chef de gare de Beloeil qui vient de quitter cet emploi suite à l’accident ferroviaire du 29 juin 1864.

Photo Pierre Gadbois 2010
La maison Jean-Baptiste-Lamothe
96 et 98, rue Richelieu, Beloeil
Lot Ptie 28, cadastre de Beloeil
Feuilleter au complet (pour membre seulement) Se connecter Devenir membre
C’est d’abord sous le nom de «maison Guertin» que la maison sise aux nos 96 et 98, rue Richelieu, à Beloeil, a été classée en vertu de la Loi sur les biens culturels en 1975. Elle a ainsi évité de justesse la démolition, suite à l’avis d’expropriation dont elle avait fait l’objet en 1974, lors de l’agrandissement de la route 232 et l’élargissement du tunnel du pont ferroviaire.
Elle fut nommée officiellement « maison Jean-Baptiste-Lamothe » par le comité d’officialisation des toponymes de la Commission des biens culturels du Québec le 7 mai 2003.

Photo Pierre Gadbois 2011
La maison Adélard-D.-Goulet
126, 134, rue Richelieu et 60, rue Saint-Georges
Lots Ptie 28 et Ptie 31, cadastre de Beloeil
Feuilleter au complet (pour membre seulement) Se connecter Devenir membre
La maison située aujourd’hui aux numéros domiciliaires 126, 134, rue Richelieu et 60, rue Saint-Georges, est composée de deux bâtiments dont l’un fut déplacé pour être réuni à un autre à la fin du XIXe siècle. Une première maison avait été construite sur le site par Joseph Pariseau vers 1882 et huit ou neuf ans plus tard, cette maison fut déménagée sur son site actuel par Adélard-Dieudonné Goulet qui y greffa un deuxième bâtiment. La première maison compose aujourd’hui la partie nord-est du bâtiment actuel construite dans le style Second-Empire en 1882, transportée sur son site actuel vers 1891 et transformée plus tard dans le style boom-town vers 1912. Quand à la partie sud-ouest du bâtiment, elle fut construite vers 1891 dans le style vernaculaire américain et annexée à la première. Ces deux bâtiments réunis sont devenus, la partie sud-ouest, la résidence du marchand Adélard-D. Goulet et la partie nord-est le magasin-général et bureau de poste de Beloeil-Station, longtemps connu sous le nom «Magasin-Général Goulet & Tétrault».

Photo : Pierre Gadbois, 2010
La maison Brousseau
154 et 154b, rue Richelieu, Beloeil
Lot Ptie 30, cadastre de Beloeil
Feuilleter au complet (pour membre seulement) Se connecter Devenir membre
La maison Brousseau a été construite vers 1860 par le docteur Jean-Baptiste Brousseau, à proximité de la voie ferrée et de la gare de Beloeil dont la construction remontait déjà à 1848. Il s’agit de la première maison à être construite en prévision du développement de ce secteur que voulait promouvoir le docteur Brousseau. Malheureusement sa maison resta pendant longtemps le seul bâtiment érigé sur un lotissement immobilier qui ne prendra son essor qu’au début du XXe siècle.

Photo : Pierre Gadbois, 2009
La maison Joseph-Douville
46, rue Choquette, Beloeil
Lot Ptie 30, cadastre de Beloeil
Feuilleter au complet (pour membre seulement) Se connecter Devenir membre
La maison Joseph-Douville est probablement la première maison à être construite sur ce qui deviendra la rue Choquette. Construite à la fin du XIXe siècle par Joseph Douville, elle subira cependant dans le dernier quart du XXe siècle, des changements importants qui modifieront son style d’origine.
Lorsqu’en 1854 Jean-Baptiste Brousseau achète la terre des héritiers de Julie Brouillet, c’était surtout pour développer le secteur de la station, suite à l’inauguration de la voie ferrée et l’établissement d’une gare à Beloeil en 1848. La gare se trouvait à quelques pas seulement de la maison de pierre érigée sur cette terre et que Julie Brouillet et son mari Pierre Brunelle avaient déjà commencé à exploiter comme auberge depuis 1850.

Photo : Pierre Gadbois, 2009
La maison Avila-Véronneau
56 et 60, rue Choquette
Lot Ptie 30, cadastre de Beloeil
Feuilleter au complet (pour membre seulement) Se connecter Devenir membre
La maison sise aux numéros domiciliaires 56 et 60, rue Choquette, à Beloeil, a été construite durant cette période pendant laquelle le style vernaculaire industriel est prépondérant dans notre architecture. Cette maison cubique, au toit en pavillon, a été construite par Avila Véronneau, menuisier de Beloeil, vers 1917.
Cyrille Choquette avait acquis en 1904, de sa belle-mère, Marie-Anne Charlotte Hertel de Rouville, veuve de Jean-Baptiste Brousseau, le lot 30 du cadastre. Il était déjà propriétaire depuis 1885 de plusieurs lots situés autour de la gare de Beloeil et envisageait sans doute depuis longtemps de développer ce secteur. Mais ce n’est qu’à compter du moment où il devient propriétaire du lot no 30 qu’il lotit ces terrains en vue de les vendre et d’intéresser également d’autres entrepreneurs à son projet de développement.

Photo : Pierre Gadbois 2009
La maison Louis-Véronneau
69, 73 et 75, rue Choquette
Lot Ptie 30, cadastre de Beloeil
Feuilleter au complet (pour membre seulement) Se connecter Devenir membre
Le 1er novembre 1915, Louis Véronneau acquiert d’Augustin Casavant père et Auguste Casavant fils, le terrain sur lequel il construit la maison sise aujourd’hui au 69, 73 et 75, rue Choquette. Ces derniers avaient acquis ce terrain, avec plus grande étendue, de Cyrille Choquette le 4 août précédent1. Aux termes de cet acte cependant, Augustin Casavant et son fils se réservaient la propriété des bâtiments de ferme qu’ils occupaient dont certains étaient construits sur le terrain vendu à Louis Véronneau.
Augustin Casavant et son fils Auguste avaient été les fermiers de Cyrille Choquette jusqu’en 1915. En 1915,

Photo Pierre Gadbois, 2009
La maison Exobie-St-Georges
106, rue Choquette
Lot Ptie 30, cadastre de Beloeil
Feuilleter au complet (pour membre seulement) Se connecter Devenir membre
La maison Exobie-St-Georges est un très bel exemple, bien conservé et restauré, d’un bâtiment de type boite-carrée ou boom-town, construit dans le premier quart du XXe siècle, comme on en retrouve de nombreux modèles dans les rues de Beloeil- Station. Construite par Alexis Perreault, cette maison a ensuite été occupée par la famille d’Exobie St-Georges de 1917 à 1980. Le nom d’Alexis Perreault ayant déjà été attribué à la maison que ce dernier occupait personnellement avec son épouse à Beloeil-Station, nous lui avons attribué le nom d’Exobie St-Georges bien qu’il n’en soit pas l’auteur, mais qui a été la propriété de sa famille pendant 63 ans.

Photo Pierre Gadbois 2011
La maison Élie-Bouvier
111, rue Choquette
Lot Ptie 30, cadastre de Beloeil
Feuilleter au complet (pour membre seulement) Se connecter Devenir membre
La maison située au 111, rue Choquette, a été construite en 1916 comme l’indique la date-portée inscrite dans la brique en façade de la maison. Elle fut construite par Élie Bouvier, cultivateur du rang des Trente, qui vint s’y établir avec son épouse au moment de sa retraite. Nous avons donc attribué au bâtiment le nom maison Élie-Bouvier.
L’emplacement sur lequel a été construite la maison Élie-Bouvier, faisait partie à l’origine de la ferme qu’exploitait Jean-Baptiste Brousseau sur le lot 30 du cadastre. Cette ferme deviendra celle de son gendre Cyrille Choquette en 1904.

Photo : Pierre Gadbois, 2010
La maison Mimie-Tremblay
121 et 125, rue Choquette
Lot Ptie 30, cadastre de Beloeil
Feuilleter au complet (pour membre seulement) Se connecter Devenir membre
La maison sise au 121 et 125, rue Choquette, a été construite par Ulysse Tremblay en 1933 alors qu’il habitait encore la maison voisine, où il exploitait un magasin-général. En 1943, Ulysse Tremblay vend la maison à sa fille Marguerite-Herminie, dite Mimie, Tremblay, qui la conserve jusqu’à son décès en 1984. Nous avons choisi de nommer la maison Mimie-Tremblay, en l’honneur de celle qui l’a habitée pendant plus de quarante ans.
Ulysse Tremblay et son épouse, Éva Roy, d’abord établis comme cultivateurs à Saint-Hilaire, sont venus s’établir à Beloeil en 1904 avec les trois enfants nés jusqu’alors de leur mariage.

Photo : Pierre Gadbois, 2009
La maison Ulysse-Tremblay
133, 137, 141 et 145, rue Choquette
Lot Ptie 30, cadastre de Beloeil
Feuilleter au complet (pour membre seulement) Se connecter Devenir membre
Le 18 février 1907, Ulysse Tremblay, menuisier à la Poudrière de Beloeil, acquiert de Cyrille Choquette le terrain sur lequel il érigera une maison qui sera agrandie à trois reprises avant de devenir le bâtiment portant aujourd’hui les nos 133 à 145, rue Choquette. Ulysse Tremblay a habité cette maison avec sa famille pendant près de 30 ans et y a exploité un magasin général pendant vingt ans.
Ulysse Tremblay est né à Saint-Hilaire en 1868, du mariage d’Alexis Tremblay et d’Herminie Auclair.

Photo : Pierre Gadbois, 2009
La maison Doutre et Lavigueur
159, 161, 163 et 165, rue Choquette
Lot Ptie 30, cadastre de Beloeil
Feuilleter au complet (pour membre seulement) Se connecter Devenir membre
La maison sise aux nos 159 à 165, rue Choquette, a été construite en 1908 par deux individus : Honoré Doutre et François Delage dit Lavigueur, tous deux manufacturiers de portes et fenêtres et propriétaires de deux moulins à scie à Beloeil- Station. Il s’agit d’une maison construite dans le style boite-carrée ou boom-town comme la majorité des maisons construites à cette époque dans ce secteur. Elle diffère cependant des autres par ses éléments décoratifs exceptionnels rarement aperçus sur ce type de bâtiment.

Photo : Pierre Gadbois, 2010
La maison Hervé-Marcoux
189 et 193, rue Choquette
Lot Ptie 30, cadastre de Beloeil
Feuilleter au complet (pour membre seulement) Se connecter Devenir membre
La maison sise au 189 et 193, rue Choquette, a été construite en bois, lambrissée de briques, par Hervé Marcoux, en 1915 ou 1916, sur un terrain mesurant 35,05 mètres (115 pieds) de front sur 30,4 mètres (100 pieds) de profondeur. Hervé Marcoux était charretier à Beloeil mais est devenu l’un des plus importants entrepreneurs de pompes funèbres de Victoriaville. C’est ici à Beloeil qu’il entreprendra auprès de Gustave Demers les rudiments de son métier de directeur de funérailles tout en travaillant pour ce dernier comme charretier. La maison qu’il a construite pendant cette période aurait pu devenir le premier salon funéraire de Beloeil.

Photo Pierre Gadbois, 2009
La maison Louis-Chauvin
199, rue Choquette
Lot Ptie 30, cadastre de Beloeil
Feuilleter au complet (pour membre seulement) Se connecter Devenir membre
Construite en 1908 par Antoine Desmarais et son fils Wilfrid, la maison sise au 199, rue Choquette a été acquise un an plus tard par Louis Chauvin. Elle restera la propriété des membres de sa famille pendant plus de 35 ans ce qui motive notre choix du nom : maison Louis-Chauvin. Mais la maison présentait alors un style bien différent de celui qu’elle présente aujourd’hui.
Le terrain sur lequel fut construite la maison Louis-Chauvin, a été détaché du lot no 30 du cadastre de la paroisse Saint-Mathieu-de-Beloeil.

Photo Pierre Gadbois 2010
La maison Émérie-L’Heureux I
231 et 235, rue Choquette
Lot 30-1, cadastre de Beloeil
Feuilleter au complet (pour membre seulement) Se connecter Devenir membre
Émérie L’Heureux arrive à Beloeil en 1914 et s’établit immédiatement à Beloeil-Station où il construit la maison sise au 231 et 235, rue Choquette. Il installe à proximité un moulin à scie, un atelier de menuiserie et une usine de portes et fenêtres. Émérie L’Heureux aura cependant construit et habité trois maisons différentes qui existent toujours sur le territoire de Beloeil. Nous avons choisi d’attribuer son nom à chacune de ces trois maisons, sous les noms de maisons Émérie-L’Heureux I, II t III.

Photo Pierre Gadbois 2011
La maison Augustin-Casavant
169, rue Cartier
Lot 30-341, cadastre de Beloeil
Feuilleter au complet (pour membre seulement) Se connecter Devenir membre
La maison sise au 169, rue Cartier, n’est plus à proprement parlé dans le secteur que nous considérons aujourd’hui comme étant Beloeil-Station. Mais elle l’était, du moins dans cette partie de Beloeil-Station que l’on nommait, de façon un peu péjorative «le Pont» et ce, quelques années après la création en 1952 de la paroisse Sainte-Maria-Goretti à laquelle cette partie de la paroisse Sacré-Coeur sera intégrée. Pour cette raison, nous avons décidé de l’inclure dans notre inventaire de Beloeil-Station.

Photo : Pierre Gadbois, 2009
La maison Arthur-Charette
228, 232 et 234, rue Choquette
Lot 30-22, cadastre de Beloeil
Feuilleter au complet (pour membre seulement) Se connecter Devenir membre
Le terrain sur lequel la maison Arthur-Charette a été construite, est un démembrement d’un plus vaste terrain, propriété d’Alfred Cadieux, plombier et agent d’immeuble de Montréal. En 1913, Alfred Cadieux avait acquis de Cyrille Choquette un vaste terrain connu déjà sous le nom de «Terrasse Choquette», compris à l’intérieur des lots 26, 28 et 30 du cadastre, dans le but de poursuivre le projet de développement immobilier qu’avait entrepris Cyrille Choquette avant son départ pour Montréal en 1909. Après les avoir subdivisés, des difficultés financières l’inciteront, en septembre 1916, à rétrocéder plusieurs de ces terrains à Cyrille Choquette avant de finalement faire faillite. Certains de ces terrains étaient cependant sujets à des promesses de vente intervenues plus tôt entre Cadieux et certains acquéreurs dont le titre était conditionnel à l’acquittement du prix de vente des terrains. Ainsi l’acquéreur, tout en ayant la possession du terrain, n’obtenait de titre valable qu’après en avoir payé le prix ou d’avoir construit une maison sur celui-ci.

Photo : Pierre Gadbois, 2010
La maison Adjutor-Therrien
220 et 220a, rue Choquette
Lot 30-21, cadastre de Beloeil
Feuilleter au complet (pour membre seulement) Se connecter Devenir membre
Adjutor Therrien, employé de la Compagnie de chemin de fer Grand Tronc, originaire de Sainte-Brigitte-des-Saults, travaille d’abord à Richmond où il épouse Dina Dionne, le 6 octobre 1887. Il vient s’établir à Beloeil, toujours employé du Grand Tronc, un peu avant 1906. Le 20 décembre 1906, Dina Dionne décède et un an plus tard, le 21 octobre 1907, Adjutor Therrien épouse en deuxièmes noces, Clarinthe Cadieux, veuve d’Alexandre Senez.

Photo : Pierre Gadbois, 2009
La maison Joseph-Véronneau
202 et 208, rue Choquette
Lot Ptie 30, cadastre de Beloeil
Feuilleter au complet (pour membre seulement) Se connecter Devenir membre
La maison sise au 202 et 208, rue Choquette, à Beloeil, a été construite par Joseph Véronneau, qualifié d’entrepreneur en 1913, au moment où il se porte acquéreur du terrain sur lequel il construira la maison dans les mois qui vont suivre son acquisition.
Nous savons cependant que Joseph Véronneau a été cultivateur et a exercé un peu de camionnage et qu’il n’a jamais construit de maison de sa vie. Cette maison a été construite par son frère Avila Véronneau qui a été l’un des menuisiers les plus prolifiques de son époque.

Photo Pierre Gadbois, 2009
La maison F.-X.-Coulombe
188 et 192, rue Choquette
Lot 30-384, cadastre de Beloeil
Feuilleter au complet (pour membre seulement) Se connecter Devenir membre
La maison sise aux 188 et 192, rue Choquette, à Beloeil, a été construite par François-Xavier Coulombe après son acquisition du terrain en 1913. L’emplacement, mesurant 24,38 mètres de largeur sur une profondeur de 38,40 mètres, avait été vendu par Cyrille Choquette à Rosario Doutre en 1907 et ce dernier l’avait vendu à son tour, toujours vacant, à François-Xavier Coulombe le 19 juillet 1913. François-Xavier Coulombe va construire dès 1913 sur cet emplacement, une maison d’un style légèrement différent de son style actuel.

Photo Pierre Gadbois, 2009
La maison Rolland-Geoffrion
148, 152 et 154, rue Choquette
Lot Ptie 30, cadastre de Beloeil
Feuilleter au complet (pour membre seulement) Se connecter Devenir membre
Ce bâtiment, sans style, difficile à classer, a été construit par Rolland Geoffrion, en 1942. Construit dès son origine pour accueillir un commerce, ce bâtiment qui a été un dépanneur, un restaurant et un salon de barbier, a tout de même été fréquenté pas de nombreux résidents de Beloeil-Station. Il a également marqué le secteur par l’excentricité de la famille qui l’a habité pendant plus de 40 ans.

Photo : Pierre Gadbois 2009
La maison Louis-Philippe-Tétreault
136, rue Corinne et 138, rue Choquette
Lot Ptie 30, cadastre de Beloeil
Feuilleter au complet (pour membre seulement) Se connecter Devenir membre
La maison sise au 136, rue Corinne et 138, rue Choquette, a été construite vers 1907, par Louis-Philippe Tétreault, un marchand de Beloeil-Station, sur un emplacement mesurant 25,91 mètres de largeur sur 39,01 mètres de profondeur. Ce dernier qui avait acquis ce terrain de Cyrille Choquette le 18 février 1907, n’a cependant jamais habité la maison. Cependant, lui et son beau-frère Adélard-D.-Goulet en ont été propriétaires pendant plus de 40 ans. Louis-Philippe Tétreault a plutôt habité une autre maison sise rue Richelieu, transformée par monsieur Paul Millier dont nous lui avons attribué le nom, attribuant plutôt à celle-ci le nom de son auteur, maison Louis-Philippe-Tétreault.

Photo Pierre Gadbois 2009
La maison Alphonse-Guilmain
121, rue Corinne
Lot Ptie 28, cadastre de Beloeil
Feuilleter au complet (pour membre seulement) Se connecter Devenir membre
Tout le secteur de Beloeil-Station autour des rues Choquette, Corinne, Perreault et Brousseau, à proximité de la voie ferrée, s’est développé dans le premier quart du XXe siècle, période marquée surtout par les bâtiments de type vernaculaire industriel et de style boite-carrée ou boom-town.
Cette petite maison sise au 121, rue Corinne, a été construite dans ce style par Alphonse Guilmain, un journalier de Saint-Hilaire, venu travailler à la Poudrière et s’établir à Beloeil, avec son épouse Alexandrine Brodeur et leur fils Gabriel en 1909.

Photo Pierre Gadbois 2009
La maison Lavallée
103 et 105, rue Corinne
Ptie 28, cadastre de Beloeil
Feuilleter au complet (pour membre seulement) Se connecter Devenir membre
Après avoir acquis de Cyrille Choquette le 8 mai 1909 un premier terrain sur lequel il construit la petite maison sise au 121, rue Corinne, Alphonse Guilmain acquiert, le 19 août 1911, un autre terrain mesurant celui-là 42,06 mètres (138 pieds) de largeur le long de la rue Corinne. Il n’aura le temps de construire sur ce terrain qu’un bâtiment qui servira de poulailler avant de décéder tragiquement en 1913.
Après son décès, sa veuve, Alexandrine Brodeur, déjà propriétaire d’une moitié indivise des immeubles, fit vendre ces immeubles en justice en qualité de tutrice de son fils Gabriel et devient propriétaire de la totalité de ceux-ci.

Photo Pierre Gadbois 2010
La maison Douville
122, rue Corinne et 145, rue Brousseau
Suivi des maisons Robillard et Fortin, 151 et 171, rue Brousseau,
Lot Ptie 28, cadastre de Beloeil
Feuilleter au complet (pour membre seulement) Se connecter Devenir membre
La maison Douville est une maison en bois de deux étages, construite vers 1905, comprenant aujourd’hui trois logements portant les nos 122, rue Corinne, 145 et 145A, rue Brousseau, à Beloeil. Acquise en 1918 par Philomène Beauchemin, veuve d’Adélard Douville, elle fut occupée pendant plus de 66 ans par cette famille dont les membres ont suffisamment marqué l’histoire de Beloeil-Station pour laisser leurs noms aux différents bâtiments qu’ils ont occupés.

Photo Pierre Gadbois 2009
La maison Gravel
100, rue Corinne, 138 et 144, rue Brousseau
Lot Ptie 28, cadastre de Beloeil
Feuilleter au complet (pour membre seulement) Se connecter Devenir membre
La maison Gravel est une maison en bois, lambrissée de briques, construite suivant le modèle boom-town, très populaire à Beloeil-Station dans le premier quart du XXe siècle. Il s’agit d’une maison de deux étages comportant trois logements, connus comme étant les nos 100, rue Corinne, 138 et 144, rue Brousseau. Construite par Georges Dubois en 1915, elle devient la propriété d’Auguste Gravel en 1916 et restera dans cette famille pendant plus de 40 ans, d’où le nom « maison Gravel » que nous retiendrons pour la désigner.

Photo : Pierre Gadbois, 2009
La maison Dubois
90 et 94, rue Corinne
Lot Ptie 28, cadastre de Beloeil
Feuilleter au complet (pour membre seulement) Se connecter Devenir membre
La maison sise au 90 et 94, rue Corinne, a été construite vers 1919 par Georges Dubois et est restée dans sa famille jusqu’en 1939, d’où le nom maison Dubois que nous avons retenu pour la désigner. Il s’agit d’une maison en bois de deux étages, construite suivant le modèle boom-town, comme la plupart des maisons construites à Beloeil-Station dans le premier quart du XXe siècle.
La plus grande partie du lot 28 du cadastre de la paroisse Saint-Mathieu-de-Beloeil dont fut détaché l’emplacement de la maison Dubois, a été acquise par Cyrille Choquette en 1885.

Photo Pierre Gadbois, 2009
La maison Anselme-Lambert
99 et 101, rue Corinne
Ptie 28, cadastre de Beloeil
Feuilleter au complet (pour membre seulement) Se connecter Devenir membre
L’emplacement sur lequel la maison sise au 99 et 101, rue Corinne, a été construite, est un démembrement du lot 28 du cadastre de la paroisse Saint-Mathieu-de- Beloeil. Ce lot avait été acquis par Cyrille Choquette en 1885. Ce dernier attendra cependant jusqu’au début du XXe siècle avant d’entreprendre de lotir tout ce territoire qui s’étend autour de la gare de Beloeil, au sud du boulevard Laurier.
Le 20 septembre 1907, Cyrille Choquette vend au notaire J. E. M. Desrochers un emplacement mesurant 19,51 mètres (64 pieds) de largeur sur une profondeur de 30,48 mètres (100 pieds).

Photo : Pierre Gadbois, 2009
La maison Mathieu
84, rue Corinne
Lot 28-63, cadastre de Beloeil
Feuilleter au complet (pour membre seulement) Se connecter Devenir membre
La maison sise au 84, rue Corinne, est un beau bâtiment construit en bois dans le premier quart du XXe siècle, suivant le modèle boom-town, très populaire dans tout Beloeil-Station. Joseph Mathieu et son fils Charles Mathieu, en terminent la construction vers 1918 et l’habiteront pendant quelques années.
La plus grande partie du lot 28 du cadastre de la paroisse Saint-Mathieu-de-Beloeil dont fut détaché l’emplacement de la maison Mathieu, avait été acquise par Cyrille Choquette en 1885.

Photo Pierre Gadbois, 2009
La maison Joseph-A.-Choquette
80, rue Corinne et 145, rue De Rouville
Lot 28-64, cadastre de Beloeil
Feuilleter au complet (pour membre seulement) Se connecter Devenir membre
La maison sise au 80, rue Corinne et 145, rue De Rouville a été construite en bois, lambrissée de briques, par Joseph-A. Choquette en 1916, dans le style vernaculaire industriel populaire à cette époque, suivant son modèle cubique ou Four-Squares.
L’emplacement sur lequel cette maison a été construite, fut détaché d’une terre acquise par Cyrille Choquette (sans lien de parenté avec l’auteur de la maison) en 1885. Depuis 1904, Cyrille Choquette est propriétaire de la majeure partie des lots 26, 28 et 30 du cadastre de la paroisse Saint-Mathieu-de-Beloeil et il entreprend alors de lotir et de vendre les emplacements qu’il possède autour de la gare de Beloeil.

Photo Pierre Gadbois 2009
La maison Armand-Bergeron
124, 126 et 130, rue De Rouville
Lot 28-103, cadastre de Beloeil
Feuilleter au complet (pour membre seulement) Se connecter Devenir membre
Le quartier de Beloeil-Station ou du Pont, comme on le désignait vers 1920, s’est développé graduellement. Après la rue Richelieu dont le développement domiciliaire va s’accentuer à compter de 1870, il faudra attendre après 1904 et surtout 1907, pour voir le quartier se développer de façon progressive jusque vers 1940. C’est sur la rue Choquette que les premières habitations vont se construire, suivi de près par la rue Corinne. Le secteur des rues Perreault et Saint-Georges, bien que subdivisé et même construit d’une maison longtemps enclavé à cet endroit, va se développer autour des années 1916 et 1920. Les emplacements le long des rues Brousseau et De Rouville seront les dernières finalement à se développer.

Photo Pierre Gadbois 2010
La maison Joseph-Bertrand
79 et 83, rue Perreault
Lot Pties 28-13, 14, 15 et 16, cadastre de Beloeil
Feuilleter au complet (pour membre seulement) Se connecter Devenir membre
La maison sise au 79, rue Perreault, a subi quelques altérations importantes dont l’orientation de sa façade sur la rue Perreault, mais elle a pourtant conservé beaucoup de son authenticité.
La maison fut vraisemblablement construite en grande partie par Herménégilde Perreault le long d’une rue projetée, à l’intersection d’un chemin privé qui permettait de rejoindre par différents passages la rue Richelieu. Elle fut occupée pour la première fois en 1916 par Joseph Bertrand et sa famille.

Photo Pierre Gadbois 2009
La maison Léopold-Handfield
59, rue Perreault
Lot Ptie 28-13, cadastre de Beloeil
Feuilleter au complet (pour membre seulement) Se connecter Devenir membre
La maison Léopold-Handfield a été construite en 1921 par la Librairie L. J. A. Derome Limitée dirigée à cette date par Roquebrune-Paul Larocque et a été utilisée essentiellement comme bâtiment industriel jusqu’en 1934. À cette date, le bâtiment est acquis par monsieur Léopold Handfield qui utilise le rez-de-chaussée comme atelier mécanique mais transforme l’étage en résidence. Bien que le rez-de-chaussée soit actuellement inutilisé, certains membres de la famille Handfield occupent toujours la maison comme résidence.

Photo Pierre Gadbois 2009
La maison Jean-Baptiste-Leblanc
71, 75 et 79, rue St-Georges
Lot 28-4 et Pties 28-5, 6, 8, 9, cadastre de Beloeil
Feuilleter au complet (pour membre seulement) Se connecter Devenir membre
Originaire de Saint-Denis, où il a exercé le notariat pendant quelques années à compter de 1864, le notaire Jean-Baptiste Leblanc vient s’établir à Beloeil vers 1881 comme chef de gare pour la Compagnie de chemin de fer Grand Tronc. En 1887, il acquiert un grand terrain, complètement enclavé derrière la voie ferrée et construit une maison comprenant trois logements. Bien qu’il n’ait pas occupé lui-même la maison, il s’agit de la seule maison que Jean-Baptiste Leblanc ait fait construire à Beloeil avant d’émigrer aux États-Unis avec sa famille vers 1895. Nous avons donc nommé cette maison la maison Jean-Baptiste-Leblanc.

Photo Pierre Gadbois 2010
La maison Wong-Yin-Bun
128 et 130, rue Saint-Georges
Lots 28-59, cadastre de Beloeil
Feuilleter au complet (pour membre seulement) Se connecter Devenir membre
Le Chinois et la maison du Chinois, c’est ainsi que la plupart de ceux qui ont vécu à Beloeil-Station dans les années 1940 désignaient ce sympathique personnage et la maison qu’il a construite et occupée pendant plus de 30 ans. Il s’appelait Wong Yin Bun et malgré son originalité, était bien intégré dans la vie communautaire de Beloeil-Station. Plutôt que la maison du chinois, nous avons préféré donner à cette maison le nom de son auteur, la maison Wong-Yin-Bun.

Photo Pierre Gadbois 2009
La maison John-Hall
164, rue Richelieu
Lot Ptie 30, cadastre de Beloeil
Feuilleter au complet (pour membre seulement) Se connecter Devenir membre
La maison sise au 164, rue Richelieu, a été construite par Alexis Perreault vers 1920. Alexis Perreault était alors commerçant et maire de la Ville de Beloeil. Il s’agit de la troisième maison qu’Alexis Perreault construisait au nord-est de la maison Brousseau, le long de la rue Richelieu.
Le nom d’Alexis Perreault ayant été attribué à la première maison qu’il a occupée pendant près de vingt ans au 170, rue Richelieu, nous avons donc attribué à celle-ci le nom de John Hall, chimiste à la CIL, à qui Alexis Perreault l’avait vendue en 1930 et qui l’a habitée pendant vingt-cinq ans.

Photo Pierre Gadbois 2011
La maison Alexis-Perreault
170, rue Richelieu
Lot Ptie 30, cadastre de Beloeil
Feuilleter au complet (pour membre seulement) Se connecter Devenir membre
La maison sise au 170, rue Richelieu, a été construite par Alexis Perreault vers 1905 dans le style vernaculaire américain encore populaire à cette date. Alexis Perreault a été un personnage important de Beloeil-Station. Il a construit plusieurs maisons et celle-ci n’est qu’une de celles qu’il a construites, mais c’est la première qu’il a habité à Beloeil- Station.
Le terrain sur lequel cette maison a été construite fait partie du lot 30 du cadastre de la paroisse Saint-Mathieu-de-Beloeil, terre sur laquelle fut érigée la maison Brousseau vers 1860. Propriété du docteur Jean-Baptiste Brousseau et après son décès en 1872, de son épouse Marie-Anne Charlotte Hertel de Rouville, celle-ci vendait cette terre en 1904 à son gendre Cyrille Choquette.

Photo Pierre Gadbois 2011
La maison Paul-Millier
176, rue Richelieu
Lot 30-48, cadastre de Beloeil
Feuilleter au complet (pour membre seulement) Se connecter Devenir membre
La maison sise au 174, rue Richelieu, a été construite vers 1912 par Alexis Perreault, en bois, lambrissée de briques, suivant son modèle cubique ou «Four Square», l’une des nombreuses variantes du style vernaculaire industriel emprunté des américains, très populaire à cette date.
Alexis Perreault est un personnage important de Beloeil-Station et son nom a déjà été attribué à la maison voisine qu’il a habitée.
Conclusion
Les pages qui précèdent, essentiellement consacrées aux maisons anciennes et à l’architecture particulière qui a prévalu à Belœil-Station au début du XXe siècle, nous permettent de constater que le quartier a tout de même eu une vie qui lui fut propre, composé essentiellement d’ouvriers travaillant dans diverses entreprises, manufactures de portes et fenêtres, moulin à scie, au Grand Tronc, au CN, à la Poudrière ou à la Fonderie et de quelques marchands. Développé pendant la période où le style vernaculaire industriel bat son plein, le quartier a également développé une architecture homogène, composée essentiellement de bâtiments de style boom-town et de quelques bâtiments de style vernaculaire américain, dont la plupart sont en bois.
Intégré à la Ville de Belœil dès les origines de la Corporation du Village de Belœil en 1903, le quartier de Belœil-Station, tel que nous le connaissons aujourd’hui, au sud de la rue Laurier et à l’est de la rue Bernard-Pilon, s’étendant au-delà du pont ferroviaire sur quelques centaines de pieds à l’est de la rue Choquette, a réellement pris naissance à compter de cette date. Il s’est cependant toujours distingué du reste de l’ensemble de la Corporation du Village et plus tard de la Ville de Belœil, tant sur le plan historique qu’architectural et est toujours demeurée un peu à part, comme à l’époque où, de l’extérieur, on le surnommait le Pont.
Belœil a aujourd’hui perdu sa gare au profit de McMasterville et les rues de Belœil-Station ont en quelque sorte perdues leur point d’ancrage. D’aucun pourrait prétendre que le quartier en a perdu son nom. Mais le quartier n’a pas perdu son âme pour autant, il constitue toujours Belœil-Station, le Pont encore pour certains, avec ses origines, son histoire et son architecture qui lui est propre.
Longtemps habitée par des familles d’ouvriers, de gens simples et habiles dont plusieurs ont construit eux-mêmes leur maison ou y ont contribué, Belœil-Station est toujours composée de familles jeunes, actives, besogneuses. Le quartier a connu ses bonheurs d’occasion, sa période d’intenses activités autour des maisons, magasins et manufactures qui se sont construits comme des champignons sur une période de quinze ans à la vitesse que se sont généralement développées les villes et villages boom-town partout en Amérique.
Malgré la disparition de la gare, Belœil-Station restera toujours Belœil-Station, le Pont encore pour certains, et dont il faut à tout prix préserver l’histoire et l’architecture particulière. Certains de ses occupants ont commencé à mieux entretenir ses bâtiments, à respecter son intégrité, à revenir aux matériaux de bases, à l’essentiel de ses éléments architecturaux. Faut-il simplement prier pour que cette tendance se propage et soit suivie par l’ensemble des propriétaires de Belœil-Station ? Pouvons-nous espérer qu’ils puissent recevoir une oreille attentive et des conseils judicieux de la part des divers services municipaux ? De plus en plus, grâce à la nouvelle loi sur les biens culturels qui tarde à être adoptée, nos municipalités auront les coudés franches s’imposer et faire en sorte qu’un quartier comme Belœil-Station conserve son unicité.
Remerciements
Pour réaliser ce projet nous avons obtenu la collaboration d’un nombre considérable de personnes qui ont accepté de nous rencontrer, de nous renseigner et de nous prêter les photos qu’ils possédaient autant des maisons que des personnages qui les ont construites et habitées. Nous ne pouvons citer tous ceux et celles qui nous ont offert leur collaboration mais certaines ont contribué de façon plus significatives que d’autres et nous tenons à les remercier.
Nous remercions particulièrement madame Francine Robillard-Rémillard pour la maison Douville, Louis-Philippe Cabana et Marcel Leblanc pour la maison Henri-Guertin, Charles-Auguste Casavant pour les maisons Casavant et Honoré-Routhier, Lise Tremblay- Renaud et Yves Bélanger pour les maisons Ulysse-Tremblay et Mimie-Tremblay, Jean- Claude Marcoux pour la maison Hervé-Marcoux, Lise Gravel, Nicole Gravel et Alain Larivière pour la maison Gravel, Guy Charette pour la maison Arthur-Charrette, Suzanne Blanchet pour la maison Louis-Chauvin, Michel et Denis L’Heureux pour les maisons Avila-Véronneau et Émérie-L’Heureux, Olivette Coulombe-Prévost et Armand Ménard pour la maison F.-X.-Coulombe, Lise Malo-Lacoste pour la maison Alphonse-Guilmain, Nicole Robert pour la maison Joseph-Bertrand, Rita Mathieu-DelVechio pour la maison Mathieu, Francine Choquette et Richard Choquette pour la maison Joseph-A.-Choquette, la maison Lavallée et la maison Wong-Yin-Bun, Cécile Marx pour la maison Armand- Bergeron, Bernard Handfield et Yolande Handfield-Rouillard pour les maisons Léopold- Handfield et Wong-Yin-Bun, Kathy et Peter Charbonneau, de la Californie, pour la maison Jean-Baptiste-Leblanc, Louise Martel-Bossé pour la maison Paul-Millier.
Plusieurs collections de photos mises à notre disposition et reliées à une famille et/ou à une maison en particulier ont également servi pour l’historique d’autres maisons. C’est le cas entre autres des collections de madame Francine Robillard-Rémillard et des frères Michel et Denis L’Heureux.
Nous remercions également mesdames France Labossière, peintre-architecte d’Otterburn-Park et Danielle Pigeon, historienne-d’art de Varennes, intéressées toutes les deux à l’histoire de la petite architecture, avec qui nous avons pu souvent discuter des styles et types d’architecture composant nos villes et villages. Nous avons eu recours à plusieurs reprises à leur expertise lors de nos trop nombreuses hésitations devant un style, une époque ou un élément particulier de décoration ou d’architecture.
Un merci également à messieurs Gino Ungaro, archiviste et Denis Laplante, directeur du service d’aménagement et de développement du territoire de la ville de Belœil, pour nous avoir facilité l’accès à certaines archives et dossiers de la ville de Belœil. Et enfin, nous remercions sincèrement monsieur Jean-Berghmans Veilleux, de la maison Primevère qui, encore une fois, a fait une première lecture et une correction de nos textes.